La Nouvelle-Calédonie n’est pas qu’une simple destination touristique de rêve avec ses longues plages de carte postale et son climat tropical. En plus de la richesse de sa biodiversité (son lagon de 24 000 kilomètres carrés est l’un des plus grands au monde), le Caillou possède également un véritable trésor géologique constitué d’immenses réserves de nickel.
Tellement immenses qu’elles représentent environ 25% des réserves mondiales de ce métal devenu essentiel à l’heure de la transition énergétique et de l’innovation technologique.
Autant dire que les tensions politiques et sociales qui font rage actuellement sur le troisième plus vaste Territoire d’Outre-Mer français ont un impact direct sur cette industrie cruciale pour le monde entier. Et pour la France en particulier qui y voit aussi un enjeu stratégique évident.
Sommaire
- Le Nickel, un “vieux” métal d’avenir ?
- Le Nickel de Nouvelle-Calédonie au milieu de la tourmente.
- Le nickel au cœur d’enjeux stratégiques locaux et nationaux.
- Quels sont les défis à surmonter pour l’industrie du nickel néo-calédonien ?
Le Nickel, un “vieux” métal d’avenir
Découvert par le chimiste suédois Axel Fredrik Cronstedt en 1751, le nickel est un métal argenté réputé pour sa résistance à la corrosion, sa ductilité, sa malléabilité, et sa stabilité à haute température. Autant de propriétés uniques qui lui ont permis de devenir un composant crucial dans de nombreux secteurs industriels et de construction au fil du temps.
Ainsi, historiquement, l’essentiel de la production mondiale de nickel (environ 60 %) est destiné à la fabrication d’aciers inoxydables, dans le but de les rendre plus résistants à la corrosion et donc indispensables dans une grande variété de secteurs industriels, aussi bien en chimie que dans l’automobile, le bâtiment, ou encore l’aéronautique.
Le saviez-vous ?
Le nickel est également utilisé dans la fabrication de pièces de monnaie, renforçant leurs caractéristiques de sécurité. Les pièces de 1 et 2 euros, par exemple, contiennent respectivement 11,3 % et 9,1 % de nickel, ce qui améliore leur résistance et leur durabilité.
Mais depuis quelques années, le nickel connaît un fort regain d’intérêt avec l’essor des nouvelles technologies et surtout la transition énergétique, notamment pour ses applications dans les batteries des véhicules électriques. Une popularité qui devrait se confirmer à l’avenir puisqu’on estime que la demande de nickel dans le seul secteur des véhicules électriques sera 14 fois plus importante en 2030 qu’elle ne l’était en 2019.
Le Nickel de Nouvelle-Calédonie au milieu de la tourmente
Actuellement, la Nouvelle-Calédonie connaît des tensions politiques et sociales très fortes, à la limite de la guerre civile, marquées par des divergences profondes sur la gouvernance et la gestion des ressources naturelles, notamment le nickel. Les réformes électorales controversées et les revendications d’indépendance des Kanaks, opposées aux désirs de maintien dans la République française des loyalistes, ont exacerbé les conflits. Ces tensions ont conduit à des manifestations, parfois violentes, et à des blocages qui perturbent gravement l’industrie du nickel.
Impact des Tensions sur l’Industrie du Nickel
Par exemple, en mai 2024, des manifestations ont conduit à la fermeture temporaire des mines et des installations de traitement du métal, affectant les livraisons aux marchés internationaux. Ces interruptions ont donc mécaniquement entraîné une augmentation significative des prix du nickel sur le marché mondial, passant de 18 510 $ à 21 275 $ la tonne métrique sur le London Metal Exchange.
De plus, les blocages et les violences ont mis en péril des milliers d’emplois et ont exacerbé les difficultés financières des entreprises minières locales, comme la Société Le Nickel (SLN) et Koniambo Nickel SAS (KNS). La mine de Goro, par exemple, détenue par Vale et récemment vendue à un consortium incluant Trafigura et d’autres acteurs locaux, a été fermée en raison des protestations violentes, mettant en danger environ 3 000 emplois directs et indirects.
Des préoccupations internationales
Forcément, les acteurs internationaux surveillent la situation de près, car toute perturbation prolongée de l’approvisionnement en nickel pourrait avoir des répercussions sur les industries technologiques et de l’énergie renouvelable à l’échelle mondiale, telles que la production de véhicules électriques, de batteries et d’autres technologies critiques. Par exemple, Tesla — qui a investi dans la mine de Goro en 2021 — pourrait voir ses coûts de production augmenter, mais surtout ses chaînes d’approvisionnement suffisamment perturbées au point de ralentir la production de ses véhicules électriques.
L’autre problème majeur à prendre en compte, et qui explique pourquoi l’industrie mondiale compte beaucoup sur le nickel de la Nouvelle-Calédonie, c’est qu’un autre grand producteur de ce métal connaît lui aussi pas mal de difficultés. Il s’agit de la Russie qui doit faire face aujourd’hui à d’importantes sanctions internationales sur ses exportations, et dont la production représente pas moins de 10% du nickel vendu dans le monde.
Le nickel au cœur d’enjeux stratégiques locaux et nationaux
La première victime des tensions à Nouméa, c’est bien évidemment la Nouvelle-Calédonie elle-même. Mais la France métropolitaine est également fortement impactée, notamment parce que le nickel de Nouvelle-Calédonie représente un atout stratégique majeur tant sur le plan économique que géopolitique.
L’importance économique et sociale du nickel en Nouvelle-Calédonie
On l’a évoqué plus haut, le nickel fait littéralement vivre une bonne partie de l’archipel néo-calédonien. Ce métal, que l’on qualifie aussi d’or vert en raison de son importance croissante dans les technologies vertes et durables, représente en effet jusqu’à 90 % des exportations de la Nouvelle-Calédonie et emploie environ un quart de sa population active.
La richesse générée par cette industrie soutient les infrastructures locales et contribue de manière significative au PIB du territoire. La stabilité de cette industrie est donc essentielle pour le développement économique et social de la région. Mais il existe malheureusement des divergences profondes entre les différentes communautés du Caillou autour de l’exploitation du nickel. Les indépendantistes kanaks et les loyalistes ont en effet des visions différentes sur la manière de gérer, et surtout de répartir, les bénéfices de cette ressource stratégique à la fois pour l’île et pour le monde.
Sans oublier l’importance cruciale d’assurer une exploitation durable et équitable pour une ressource qui est devenue, ironiquement, l’un des symboles de l’économie vertueuse.
Un métal au cœur des enjeux stratégiques de la France
Au-delà de l’île, le nickel de Nouvelle-Calédonie représente également un atout stratégique majeur pour la France, tant sur le plan économique que géopolitique. Avec 25 % des réserves mondiales de nickel sur l’un de ses territoires, la France détient en effet une grande partie d’une ressource critique dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques, smartphones, et autres technologies de pointe. Une ressource essentielle pour la transition énergétique, mais aussi pour la compétitivité technologique de la France et de l’Europe face à des acteurs majeurs comme la Chine.
Cet aspect stratégique du problème est vraiment pris au sérieux à Paris, qui met régulièrement en place des initiatives pour soutenir l’industrie minière en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, en 2023, le gouvernement français a proposé un « pacte du nickel » qui inclut une aide d’urgence de 200 millions d’euros pour aider à réduire les coûts de production et stabiliser le secteur. Ce plan vise notamment à renforcer la compétitivité de l’industrie minière face aux concurrents, et notamment le géant Indonésien qui reste de très loin le plus gros exportateur de nickel dans le monde, et dont les coûts de production sont très bas.
Enfin, n’oublions pas que la Nouvelle-Calédonie occupe une position hautement stratégique dans le Pacifique Sud, une région où les tensions géopolitiques sont croissantes, notamment en raison de la compétition entre la Chine et les États-Unis. La France, qui cultive toujours son soft power, trouve là une opportunité unique de stabiliser la région en évitant que l’une de ces grandes puissances finisse par dominer cette partie du monde. L’an dernier, on pouvait lire dans le journal The Diplomat (premier média de la région Asie-Pacifique) que la France « veut agir comme une puissance stabilisatrice, attachée à un multilatéralisme efficace fondé sur l’État de droit et le refus de la coercition ». Et cela passe, entre autres, par un soutien actif à l’industrie du nickel de Nouvelle-Calédonie, afin de sécuriser les approvisionnements et renforcer la présence française dans le Pacifique.
Les défis à surmonter pour l’industrie du nickel néo-calédonien
La première chose à comprendre, et surtout à faire comprendre aux principaux acteurs des tensions ce petit bout de France du Pacifique, c’est que l’industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie est tout simplement cruciale à l’échelle du monde entier. Avec une demande qui ne cesse de croître, l’archipel a réellement le potentiel de jouer un rôle majeur dans la transition énergétique mondiale, ce qui offre en outre des opportunités significatives pour l’économie locale.
Mais il faudra pour cela trouver un consensus sur la gouvernance et la répartition des bénéfices de l’industrie minière afin d’assurer une exploitation stable et durable des ressources. D’autant plus que les tensions actuelles créent un climat d’incertitude qui influe, non seulement sur la production de nickel, mais aussi sur l’intérêt d’éventuels investisseurs.
Or, les coûts élevés de production, en partie dus aux coûts de l’énergie et aux infrastructures locales souvent vieillissantes, rendent difficile la concurrence avec d’autres grands producteurs comme l’Indonésie. Pour maintenir et renforcer sa position sur le marché mondial, l’industrie néo-calédonienne doit donc permettre à des acteurs extérieurs mais aussi locaux d’investir dans des nouvelles technologies d’extraction et de traitement du nickel, afin d’améliorer l’efficacité des exploitations et de réduire les coûts de production. Le tout, bien entendu, en développant des méthodes industrielles plus propres et des pratiques minières durables, dans le but de préserver l’extraordinaire richesse du patrimoine naturel de l’île.
Autant de défis qui nécessitent un retour à la stabilité pour attirer des capitaux sur l’archipel et trouver enfin un équilibre entre développement économique, stabilité politique et préservation de l’environnement.
Ce qu’il faut retenir :
- Les réserves de nickel en Nouvelle-Calédonie représentent environ 25% des réserves mondiales.
- Principalement destiné à la fabrication d’aciers inoxydables depuis plus d’un siècle, le nickel est devenu essentiel à l’heure de la transition énergétique et de l’innovation technologique, notamment pour ses applications dans les batteries des véhicules électriques.
- Actuellement, la Nouvelle-Calédonie connaît des tensions politiques et sociales très fortes qui pénalisent lourdement l’industrie minière du nickel, faisant grimper le cours du métal, mais ayant aussi d’importantes répercussions sur l’emploi et l’activité économique de l’archipel.
- Le nickel représente en effet jusqu’à 90 % des exportations de la Nouvelle-Calédonie et fait vivre environ un quart de sa population active.
- Le nickel est également une ressource hautement stratégique pour la France, non seulement pour la transition énergétique, mais aussi pour sa compétitivité technologique face à des acteurs majeurs comme la Chine.
- La Nouvelle-Calédonie occupe également une position stratégique dans le Pacifique Sud, zone de tensions économiques et politiques entre la Chine et les États-Unis.
Auteur et consultant depuis plus de vingt ans dans le domaine de la communication stratégique, il a plusieurs fois travaillé pour le compte d'entreprises financières dont il décrypte aujourd'hui les coulisses et les mécanismes économiques de base à l'intention du plus grand nombre.
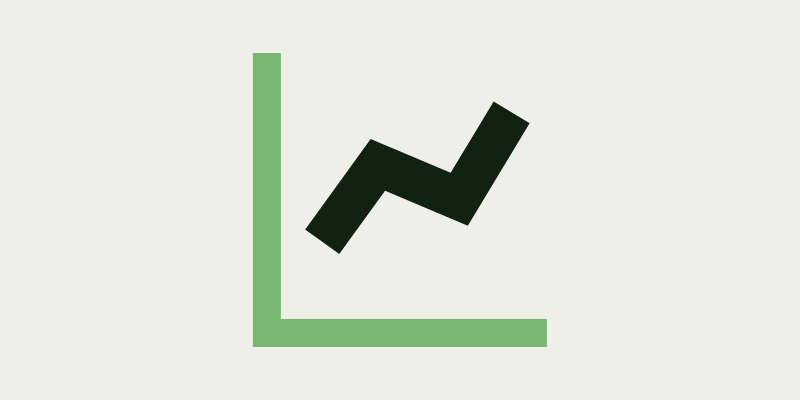
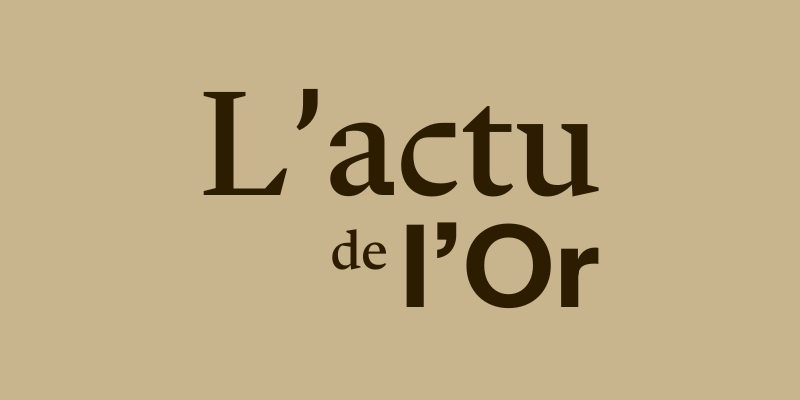
C’est pas demain que notre nickel sera compétitif.
Bonjour,
Quand un acteur représente le quart d’un marché mondial en pleine expansion, avec une demande qui explose et des perspectives de croissance à trois chiffres, il peut se permettre de ne pas être forcément le moins cher.
Néanmoins, votre remarque est intéressante. Qu’est-ce qui vous fait dire que le nickel français n’est pas compétitif ? Et qu’il ne le sera pas davantage à l’avenir ?
Merci d’avance pour les informations que vous pourrez apporter en complément de notre article.